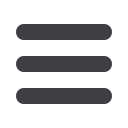

905
FLAUBERT, Gustave.
Lettre adressée à Louise Colet
.
Sans lieu ni date
[Croisset, 6 ou 7 août 1846].
Lettre autographe ; 10 pages in-4 [219 x 175 mm]. Date de la main de Louise Colet en tête.
Extraordinaire et très longue lettre amoureuse adressée à Louise Colet peu après le début
de leur rencontre.
Tumultueuse, la liaison de Gustave Flaubert avec Louise Colet (1810-1876) est à l’origine d’une
correspondance justement célèbre.
C’est à Paris, dans l’atelier du sculpteur Pradier, que Gustave Flaubert fit, en juin 1846, la connaissance
de Louise
née
Révoil, de plus de dix ans son aînée. Écrivain, mariée en 1834 au flûtiste Hippolyte
Colet, elle composait essentiellement des poèmes dont les recueils furent plusieurs fois couronnés
par l’Académie française.
La liaison avec Flaubert débuta le 29 juillet 1846. Rentré à Croisset, Flaubert lui écrivit souvent et
longuement. Ils se rencontraient quelquefois à Mantes ou à Paris, mais moins fréquemment qu’elle
ne l’aurait souhaité. Amante et interlocutrice avec qui il échangeait des idées et parlait de littérature,
elle inspira à “l’ours de Croisset” quelques-unes de ses plus belles lettres.
Après une première rupture en 1848, Flaubert renoua dès son retour du voyage en Orient – jusqu’en
1855. “
Tu es bien la seule femme que j’ai aimée et que j’ai eue
”, lui déclare ici le misogyne sentimental.
Deuxième lettre adressée par Flaubert à Louise Colet : le nouvel amant s’y dépeint sans
fard, ne dissimulant ni ses tourments, ni la passion qui le dévore.
“
Je suis brisé étourdi comme après une longue orgie – Je m’ennuie à mourir. J’ai un vide inouï dans le cœur, moi si calme
naguère si fier de ma sérénité et qui travaillais du matin au soir avec une âpreté soutenue. Je ne puis ni lire ni penser
ni écrire. Ton amour m’a rendu triste. Je vois que tu souffres – Je prévois que je te ferai souffrir. Je voudrais ne jamais
t’avoir connue pr toi, – pr moi ensuite et cependant ta pensée m’attire sans relâche. J’y trouve une douceur exquise.
Ah ! qu’il eût mieux valu en rester à notre première promenade.
[…]
Tu vas croire que je suis dur. Je voudrais l’être. Tous ceux qui m’abordent s’en trouveraient mieux et moi aussi dont le
cœur a été mangé comme l’est à l’automne l’herbe des prés par tous les moutons qui ont passé dessus. Tu n’as pas voulu me
croire quand je t’ai dit que j’étais vieux. Hélas ! oui. Car tout sentiment qui arrive dans mon âme s’y tourne en aigreur
comme le feu vin que l’on met dans des vases qui ont trop servi. – Si tu savais toutes les forces internes qui m’ont épuisé,
toutes les folies qui m’ont passé par la tête, tout ce que j’ai essayé et expérimenté en fait de sentiments et de passions tu
verrais que je ne suis pas si jeune. C’est toi qui es enfant, c’est toi qui es fraîche et neuve, toi dont la candeur me fait
rougir. Tu m’humilies par la grandeur de ton amour. Tu méritais mieux que moi. Que la foudre m’écrase, que toutes les
malédictions possibles tombent sur moi si jamais je l’oublie. Te mépriser ! m’écris-tu parce que tu t’es donnée trop tôt à
moi. As-tu pu le penser ! Jamais jamais quoi que tu fasses, quoi qu’il arrive. Je te suis dévoué pour la vie à toi à ta fille à
ceux que tu voudras. C’est là un serment, retiens-le, uses-en. […]
Oui je te désire et je pense à toi. Je t’aime plus que je ne t’aimais à Paris. Je ne puis plus rien faire, toujours je te revois
dans l’atelier debout près de ton buste les papillotes remuantes sur tes épaules blanches, ta robe bleue – ton bras – ton
visage que sais-je tout. Tiens. Maintenant la force me circule dans le sang. Il me semble que tu es là je suis en feu mes
nerfs vibrent... tu sais comment... tu sais quelle chaleur ont mes baisers.
Depuis que nous nous sommes dit que nous nous aimons tu te demandes d’où vient ma réserve à ajouter « pr toujours »
prquoi ? C’est que je devine l’avenir moi.
[…]
Je pleure trop en dedans pr verser des larmes au dehors. Une lecture m’émeut plus qu’un malheur réel. Quand j’avais une
famille j’ai souvent souhaité n’en avoir pas, pr être plus libre, pr aller vivre en Chine ou chez les sauvages. Maintenant
que je n’en ai plus je la regrette et je m’accroche aux murs où son ombre reste encore.
[…]
Mais j’ai le pressentiment d’un
malheur immense pr toi. J’ai peur que mes lettres ne soient découvertes, qu’on apprenne tout. – Je suis malade de toi.”
La distance géographique rend leur liaison compliquée
.
“Ah ! si j’avais vécu à Paris. Si tous les jours de ma vie avaient pu se passer près de toi oui je me laisserais aller à ce
courant sans crier au secours. J’aurais trouvé en toi pr mon cœur mon corps et ma tête un assouvissement quotidien qui
ne m’eût jamais lassé. Mais séparés ; destinés à nous voir rarement c’est affreux. Quelle perspective ! et que faire prtant...
“
Tu es
bien
la seule
femme
que j’ai
aimée
et que
j’ai eue
”
Je ne conçois pas comment j’ai fait pr te quitter.
[…]
J’aurais voulu passer dans ta vie comme un frais ruisseau qui en eût
rafraîchi les bords altérés et non comme un torrent qui la ravage. Mon souvenir aurait fait tressaillir ta chair et sourire
ton cœur.
[…]”
Louise Colet le presse de lui adresser quelque chose de sa main :
“Tu veux que je t’envoie quelque chose de moi. – Non – tu trouverais tout trop bien. Ne m’as-tu pas assez donné sans y
joindre tes éloges littéraires. Tu veux donc achever de me rendre fat. Et puis je n’ai rien de lisible ; tu ne t’y reconnaîtrais
pas au milieu des ratures et des renvois n’ayant rien fait recopier. N’as-tu pas peur de te gâter le style en me fréquentant.
[…]
Autrefois la plume courait sur mon papier, avec vitesse. Elle y court aussi maintenant mais elle le déchire. Je ne peux
pas faire une phrase – je change de plume à toute minute – parce que je n’exprime rien de ce que je veux dire.
[…]”
Un saltimbanque, fataliste et réfractaire.
“Le fond de ma nature est quoi qu’on dise le saltimbanque. J’ai eu dans mon enfance et ma jeunesse un amour effréné des
planches. J’aurais été peut-être un grand acteur si le ciel m’a[vait] fait naître plus pauvre.
[…]
Il n’y a pr moi dans le monde que les beaux vers, les phrases bien tournées, harmonieuses, chantantes, les beaux couchers
de soleil, les clairs de lune, les tableaux colorés, les marbres antiques et les têtes accentuées. Au-delà rien. J’aurais
mieux aimé être Talma que Mirabeau parce qu’il a vécu dans une sphère de beauté plus pure. – Les oiseaux en cage me
font tout autant de pitié que les peuples en esclavage. De toute la politique il n’y a qu’une chose que je comprenne c’est
l’émeute. Fataliste comme un Turc je crois que tout ce que nous pouvons ne faire pr le progrès de l’humanité ou rien c’est
absolument la même chose.
[…]
Je suis avant tout l’homme de la fantaisie, du caprice, du décousu. J’ai songé longtemps
et très sérieusement (ne va pas rire c’est le souvenir de mes plus belles heures) à aller me faire renégat à Smyrne.
À quelque jour j’irai vivre loin d’ici et l’on n’entendra plus parler de moi – Quant à ce qui d’ordinaire touche les hommes
de plus près et ce qui pr moi est secondaire – en fait d’amour physique, je l’ai toujours séparé de l’autre. Je t’ai vu
railler cela l’autre jour à propos de J.J.. C’était mon histoire – Tu es bien la seule femme que j’aie aimée et que j’ai eue.
Jusqu’alors j’allais calmer sur d’autres les désirs donnés par d’autres – Tu m’as fait mentir à mon système, à mon cœur,
à ma nature peut-être qui incomplète d’elle-même app cherche toujours l’incomplet.
J’en ai aimé une depuis 14 ans jusqu’à 20 sans le lui dire – sans lui toucher – et j’ai été près de trois ans ensuite sans
sentir mon sexe. J’ai cru un moment que je mourrais ainsi. J’en remerciais le ciel.
[…]”
















