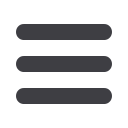

300
VERNE Jules (1828-1905).
7 L.A.S. « J. Verne » (une non signée), juillet-décembre 1848,
à ses parents; 22 pages petit in-4, 6 adresses
(quelques bords légèrement effrangés).
Exceptionnel ensemble de sept lettres de jeunesse en partie
inédites, racontant à ses parents ses débuts à Paris
.
En 1848, Jules Verne a vingt ans. Après un premier séjour à Paris
où il a passé les examens de sa première année de droit, il quitte
définitivement Nantes pour la capitale afin d’y poursuivre ses études.
Son père, avoué à Nantes, espérait que son fils lui succèderait. En
compagnie d’un autre étudiant, Edouard Bonamy, lui aussi originaire
de Nantes, il s’installe rue de l’Ancienne Comédie, au carrefour de
l’Odéon. Cette arrivée suit immédiatement la révolution de 1848 qui a
mis fin au règne de Louis-Philippe et les terribles journées de juin qui
ont vu la répression sanglante des ouvriers.
Cette exceptionnelle série de sept lettres, qui toutes prennent place
dans une année capitale pour la formation du jeune Jules Verne,
constitue un document extraordinaire pour la connaissance de l’auteur
des
Voyages extraordinaires
. On y apprend tout de sa vie matérielle
à Paris, ses ennuis d’argent, de santé, le déroulement de ses études.
On y voit également la force des liens qui l’attachent à sa famille; on
y découvre les opinions politiques du jeune homme; on assiste à ses
premiers pas dans les salons littéraires, et, derrière tout cela, perce
la passion de la littérature qui va bientôt l’emporter sur le droit; elles
offrent aussi une série de tableaux pris sur le vif : les rues de Paris
après la mitraille, un rassemblement populaire, une intervention de
Victor Hugo à la Chambre…
Pleines de verve et d’allant, remplissant les pages d’une petite écriture
serrée, elles sont écrites dans un style vif, parfois ironique, et laissent
deviner le futur écrivain. Nous ne pouvons en donner ici qu’un rapide
aperçu. Elles sont toutes, sauf une, écrites de Paris en 1848 : 17 juillet,
21 juillet, 5 août (Provins), 27 novembre, 6 décembre, 12 décembre,
et 21 décembre.
Jules Verne et sa famille
. C’est la première fois que Jules Verne quitte
durablement sa famille, à laquelle le lie une tendresse réelle : pour ses
parents, son frère bien-aimé Paul, engagé dans la marine, les « petites
filles » ses trois sœurs. Un amusant passage rappelle la complicité
qui unit le père et le fils : « je n’ai emporté que le linge nécessaire que
j’ai pu trouver dans ma boîte à chapeau. On peut tout mettre dans ces
boîtes-là; il me souvient qu’à l’abri protecteur de la tienne, tu transportais
en fraude chez Mme Nispreuve le remplacement d’un pot de chambre
que j’avais cassé »… Jules donne un beau portrait de sa grand-mère
paternelle : « la grand’ maman est étonnante d’autorité, d’intelligence,
d’amabilité. Je reste en extase devant elle »… Avec ses oncles, le
cousin Charles, la tante Charuel, la famille Verne forme un clan soudé
qui entoure et soutient le jeune Jules dans ses débuts à Paris. On
relève aussi une discrète allusion à sa vie sentimentale, lorsque Jules
pose dans sa première lettre une question qui semble innocente : «Ah,
Dieu ! j’oubliais, il y a une chose qui ne m’abandonne pas au milieu de
mes préoccupations de Paris ? Que peut-il être arrivé à propos d’un
mariage d’une certaine demoiselle que vous connaissez bien, et qui
devait s’effectuer mardi; j’avoue que je ne serais pas fâché d’être fixé
à ce sujet »… [allusion au mariage d’Herminie Arnault Grossetière,
avec Armand Terrien de la Haye; Herminie avait été son premier amour,
pour qui il écrivit tous ses poèmes de jeunesse pendant deux ans.]
La vie matérielle à Paris
. Le jeune homme n’a pas la vie facile. Son
père lui adresse une modeste pension mensuelle et lui demande des
comptes précis. Tout naturellement, ces questions d’argent occupent
une place importante dans ces lettres. La première de ces sept lettres,
qui est aussi la première connue que Jules Verne écrivit de Paris, pose
les bases de cet accord. Après avoir rendu compte de ses dépenses
de nourriture, etc., le jeune homme écrit à son père : « Il reste donc
195 francs pour examen, et dépenses imprévues. Eh bien, examen et
inscription, 165 francs. Il ne reste que 30 francs pour blanchissage, port
lettres, garçons, que sais-je. Cette somme est forte il est vrai; aussi ne
prétends-je pas la dépenser. Au reste, tout ceci ne doit pas être une
question de chiffres, mais bien de confiance; c’est surtout ainsi que je
la comprends, et la liquidation mensuelle le prouvera, je l’espère »… La
lettre du 6 décembre nous offre un compte rendu exact et détaillé de la
façon dont part son argent, en même temps qu’un cri de détresse : « Je
ne fais que payer, à Paris ! Ainsi sur les cent francs laissés j’ai achevé
le paiement du tailleur. De sorte qu’il ne m’est plus resté que cinquante
francs sur lesquels je vis »… Dans ces conditions, le moindre imprévu
tourne à la catastrophe : « Ma maudite montre me coûte 6 francs de
réparation ! mon parapluie 15 francs, et ici j’ai été obligé de me four-
nir d’une paire de bottes et d’une paire de souliers, de sorte qu’avec
100 francs du facteur, mais sans avoir rien dépensé pour moi, je me
trouve aussi à sec que le trésor public ! »… Au passage, on voit que
l’étudiant en droit, s’il n’est guère doué pour les mathématiques, ne
manque pas d’humour : « ces questions de chiffres me donnent un mal
de tête affreux, à tel point que par antipathie je ne lis plus les séances
concernant la rectification du budget de 1848, qui ne laissent pas d’être
amusantes et variées ! »… Tout cela est dit avec bonne humeur, mais
ce budget serré va cependant avoir des conséquences néfastes sur
sa santé. Dans la lettre à sa mère (27 novembre), il ne cache rien de
ses problèmes : « À part ces vomissements dont je t’ai parlé et qui ne
sont pas restés, j’ai des coliques perpétuelles; elles ne veulent pas me
quitter et me fatiguent. Je mange pourtant fort peu ! Est-ce un déjeuner
sans viande qui me donne ce dérangement ? Sont-ce les mets d’une
qualité inférieure ? je ne sais. Bref au moment où je t’écris, j’ai le ventre
coupé en deux ! »… S’étant évanoui chez un camarade étudiant en
médecine, celui-ci attribue la cause de ce malaise au mauvais genre
de repas qu’il fait : « Il est certain que les coliques ne me quittent pas.
Il a prétendu que le matin la viande m’était indispensable, et que si je
n’y prenais garde, mon état pourrait s’empirer. S’il faut le faire, c’est une
grave augmentation du déjeuner, qui me reviendra à près d’1 franc. Je
sais bien moi-même que tous les jours j’ai des étourdissements avant
dîner – ce dîner ne peut me conduire au déjeuner, et le déjeuner ne
saurait me mener au dîner ! »… On le voit, le futur romancier riche et
comblé a connu la faim à ses débuts.
Jules Verne étudiant
. Cette correspondance révèle le peu d’enthou-
siasme que lui inspirent ses études de droit, mais aussi le sérieux qu’il
met à préparer son examen : « J’ai revu l’instruction criminelle, et le
code pénal; je m’occupe maintenant de la procédure, et je finirai par
le code civil. C’est ce qu’il y a de mieux »… Comme tout étudiant, il
redoute la sévérité (la perversité) des examinateurs (21 juillet) : « Les
examinateurs sont d’une sévérité remarquable. Il refuse de candidats un
nombre effrayant. Cela fait peur. Ce sont des questions qui ne viennent
ni d’Adam ni d’Ève, qui surgissent tout d’un coup sans qu’on puisse
assigner l’endroit d’où elles sortent. Il faut qu’elles viennent de l’Enfer !
Il faut qu’ils s’amusent à rechercher tout ce qu’il y a de plus difficile et
de plus inattendu en fait de questions pour vous le jeter au nez, puis
ils vous disent : j’en ai parlé à mon cours. À cela, il y a certaines gens,
comme moi, qui ne peuvent rien répondre »… Début août, il passe et
réussit le fameux examen : « Tu as vu que j’ai été reçu mieux que je
ne l’espérais vu la série de professeurs sous lesquels j’étais tombé.
Ainsi voilà ma seconde année heureusement terminée. Qu’il en soit
ainsi de la troisième »…
L’histoire et la politique
. Jules Verne arrive à Paris, dans une période
particulièrement agitée de son histoire. La révolution de février 1848 a
instauré la République, mais en juin, l’armée, sous les ordres du général
Cavaignac, massacre la foule qui exigeait des réformes plus radicales.
Moins d’un mois après ces journées, le souvenir en reste vivace : « J’ai
parcouru les divers points de l’émeute, rues St-Jacques, St-Martin, St
Antoine, le petit pont, la belle jardinière; j’ai vu les maisons criblées de
balles et trouées de boulets. Dans la longueur de ces rues, on peut suivre
la trace des boulets qui brisaient et écorniflaient balcons, enseignes,
corniches, sur leur passage; c’est un spectacle affreux, et qui néanmoins
rend encore plus incompréhensibles ces assauts dans les rues ! »…
Quelques mois plus tard : « Hier soir d’immenses troupes d’hommes
ont parcouru les boulevards avec d’horribles vociférations. De fortes
patrouilles circulaient dans les rues; partout des groupes fort animés.
On est, en général, pour Bonaparte, et à moins d’une fraude insigne, on
présume qu’il doit être nommé. Une guerre, une émeute ne peuvent être
maintenant que guerre civile »…. Mais le jeune homme ne prend pas les
choses au tragique : « Je vois que vous avez toujours des craintes en
province; vous avez beaucoup plus peur que nous n’avons à Paris. La
fameuse journée du 14 juillet s’est passée sans mouvement; et c’est le
150
















