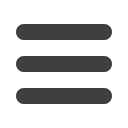
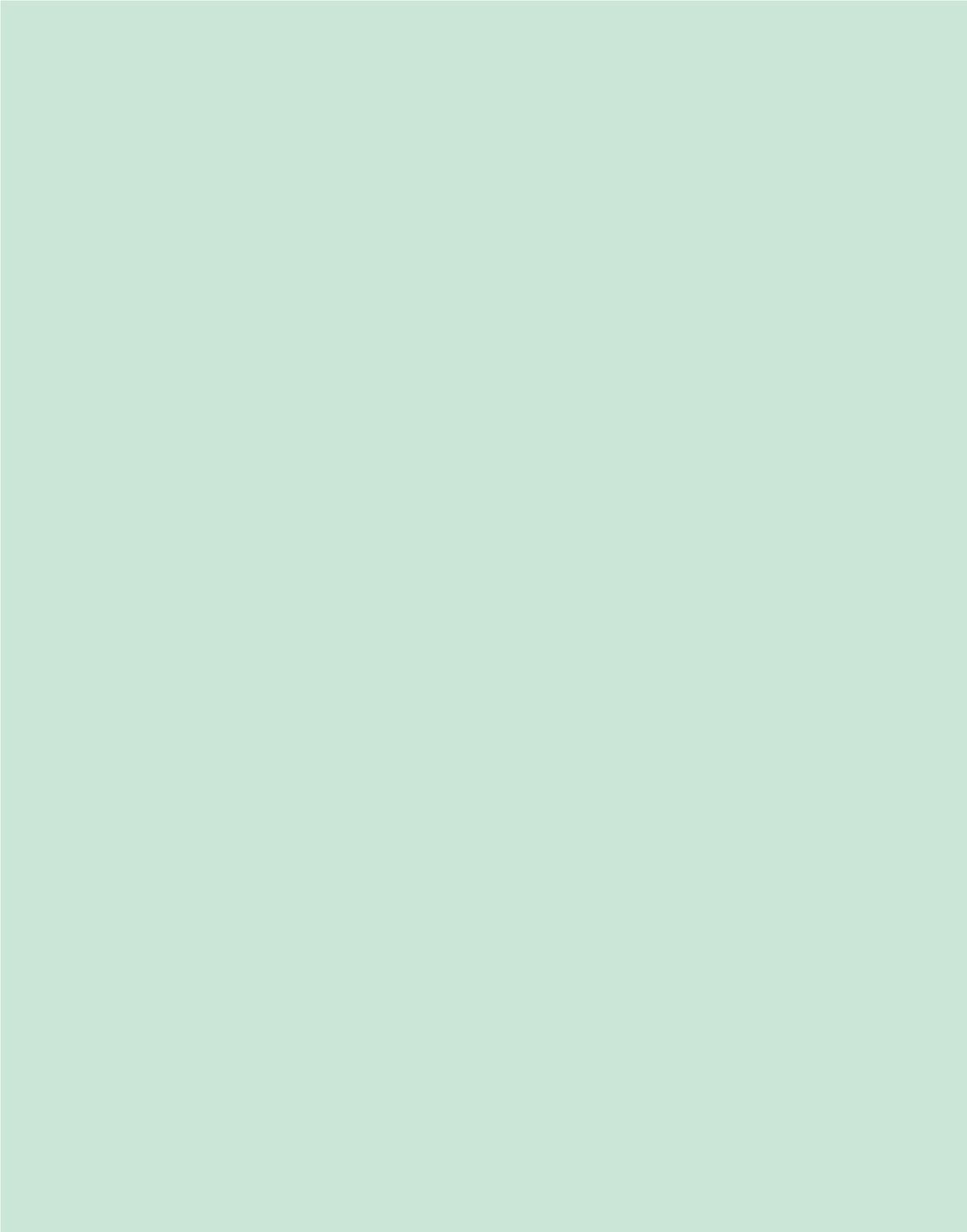
6
Henry de Monfreid : aventures et manuscrits
RTCURIAL
14 juin 2016 14h. Paris
Henry de Monfreid
par Joseph Kessel
J’ai eu la bonne fortune, écrit-il,
de rencontrer Monfreid à Paris,
alors que personne en France ne
connaissait son nom. Il avait déjà
passé la cinquantaine. Malgré cela,
la mobilité de ses mouvements et leur
souplesse étaient d’un jeune homme.
Sa démarche prompte et silencieuse,
ses yeux d’un bleu intense sous des
sourcils noirs faisaient songer en
même temps à la brousse et à la mer.
La race catalane se voyait dans l’ovale
long, osseux, dans le nez aquilin.
Un hâle indélébile, qui avait touché
jusque sous la peau, l’apparentait
aux Arabes. Il était
d’ailleurs
que
les autres hommes. Son costume
ne l’habillait pas, il le couvrait
seulement. Dès le premier coup
d’œil, on reconnaissait que ses vrais
vêtements étaient le feu du soleil, le
vent du large. Sa voix précise, voilée
semblait faite pour raconter les
combats contre les requins, la plongée
aux perles, les poissons-fleurs, les
mutilations des vaincus.
des îles vierges, bref, depuis l’Égypte
jusqu’aux Seychelles, il suffisait de
prononcer le nom de Monfreid pour
que le Français, l’Anglais, l’Italien,
pour que le Somali, l’Abyssin, le Galla,
l’Arabe et le Dankali le reconnussent
et que chacun le mêlât à quelque récit
violent et fantastique.
Monfreid, sans le chercher,
avait inspiré une légende sur les
côtes tragiques de la mer Rouge.
L’imagination certes est sans frein
chez les êtres primitifs, et même chez
les blancs que frappe un terrible
soleil. Mais, en vérité, cette existence
donnait créance au prodigieux.
Fils de Daniel de Monfreid, peintre
catalan ami de Gauguin, Henry de
Monfreid débuta mal. Il fut refusé
à Polytechnique au début du siècle
et se ruina ensuite dans des affaires
et des amours médiocres. Sans un
sou, le cœur vide, il s’embarqua
pour l’Abyssinie, sur la foi de vagues
Nous sommes partis ensemble
pour les eaux et les terres qui
l’avaient marqué à jamais. J’ai été
son hôte à Diré-Daoua, dans son
usine électrique et à sa minoterie,
à Haraoué, dans sa maison, dans
son jardin, au milieu de l’eau
murmurante, des caféiers, des
bananiers, des Gallas qui battent la
doura en chantant et des esclaves qui
vont chercher du bois. J’ai vécu sur sa
terrasse d’Obock où sont accumulés
voiles, cordages, petits canons
d’un autre âge, toute la mer, toute
l’aventure.
Il m’a fait connaître le Gubet Kharab
et l’îlot du Diable. J’ai essuyé le vent
furieux du Bab-el-Mandeb sur son
boutre avec son équipage noir. Et
que ce fût à Djibouti ou bien dans la
brousse éthiopienne, parmi les pierres
noires hantées des sauvages Danakil,
en Érythrée, ou dans les ports du
Yémen, dans les sables du Hedjaz,
chez les plongeurs de perles au creux
renseignements, où il était question
de commerce de café.
Il avait alors trente ans. Il considérait
que sa vie était achevée.
Elle commença.
Il faut à certains hommes, pour
développer leurs forces secrètes et
fécondes, un climat spécial, aussi
bien spirituel que physique. Le destin
de Monfreid était de découvrir le sien
alors qu’il croyait aller à une retraite
végétative.
Ces étendues farouches, peuplées
d’hommes rapides et âpres, baignées
par une mer brûlante, où ne
fréquentaient guère que les sambouks
des trafiquants arabes et les zarouks
des pirates zaranigs, il sentit
soudain qu’il leur appartenait. Sans
doute une ascendance mêlée, une
misanthropie naturelle, un sang de
contrebandier, un amour passionné
de la mer avaient formé chez lui
















